
L’absurde, c’est un non sens. C’est prendre le chemin le plus long pour arriver le plus vite.
Les acteurs sont des personnages avant tout, des petits bonshommes, des personnages qui vont illustrer mon œuvre. Je fais des dessins et ils jouent suivant mes dessins. Ce sont des formes géométriques dans l’espace, qui se déplacent pour que le public comprenne ce que j’ai voulu dire, ce qui n’est pas toujours évident. Car je vais le dire, quand on passe mon film, je suis le premier spectateur. Je suis toujours surpris et je me demande qui a fait ce film-là. Quand je tourne, je ne suis plus moi-même, je suis possédé par I.Y.
Les acteurs amateurs sont pour moi les véritables acteurs. Les professionnels ne sont pas des acteurs, ce sont des industriels de l’interprétation. Ils savent qu’ils jouent un rôle, ils ne peuvent pas se mettre en porte-à-faux parce que ça peut jouer contre leur personnalité dans le futur. Ils savent très bien qu’ils seront payés à la seconde où on verra leur gueule à l’écran. Chez moi, les acteurs sont des amateurs, ils se soucient très peu de savoir combien de temps on les voit à l’écran. Ce qui compte pour eux, c’est qu’ils s’amusent et qu’ils continuent à faire du cinéma dans une bonne ambiance. Et c’est tout ce qu’ils demandent.
L’Allemagne exerce une grande fascination sur moi. C’est un pays qui se ressaisit et qui remonte, même après les bombardements de Dresde, de Cologne, de Berlin et toutes ces villes massacrées, bombardées par les avions anglo-américains, toutes ces villes détruites par les chars russes, par Staline, par les T34. Après tout cela, l ‘Allemagne a été réduite à néant, il n’y avait plus une seule maison qui tenait debout dans les grandes villes. A peine dans les provinces, dans les villages éloignés restait-il quelques maisonnettes debout… Tout a été rasé car le but de la Bomber Command était de raser l’Allemagne. Et à l’heure actuelle, le pays d’Europe qui est le plus moderne, je pense que c’est l’Allemagne. Car l’Allemand se ressaisit et se recrée vite. C’est comme un ver de terre, l’Allemand, vous le coupez en deux et il se reconstitue. Moi, je suis fasciné par l’Allemagne, par cette langue germanique que je ne connais pas et qui tout à la fois m’effraie et me fascine. Je pense que l’Allemagne est la seule qui est capable de diriger l’Europe dans le futur.
L’argent est nécessaire pour faire un film. Mais je dois dire que je suis totalement contre le fait que certains films français coûtent 10, 15, 20 millions d’euros. C’est énorme. On pourrait faire des films qui coûtent moins cher. L’acteur doit gagner moins. Il est impensable que des acteurs — dont je tairai le nom, mais c’est un type que je connais — gagnent un million d’euros par film alors qu’il y a beaucoup de techniciens, de cadreurs, d’assistants opérateurs et de jeunes stagiaires qui doivent ramer pour payer leur appartement, alors que l’acteur, lui, c’est celui qui ramasse la galette. L’acteur, c’est celui qui gagne le plus dans le film. Les gens croient que c’est le producteur ou le réalisateur mais ce n’est pas vrai. La cote de popularité de l’acteur, c’est ça qui fait le budget d’un film. Il y a plus de la moitié du budget du film qui va rien que pour l’acteur principal. Pour moi, c’est une folie car l’acteur principal ne mérite pas ça. L’acteur principal mérite un salaire moindre. Si le film dure un mois, il devrait gagner environ 2000-2500 euros. Je pense que c’est bien payé pour un acteur. Mais un million d’euros, non, c’est beaucoup trop. Alors on est surpris de voir le coût des productions. Diminuons le prix des productions ! Produisons plus avec moins ! Et diminuons le prix des entrées ! Pourquoi les gens doivent-ils payer maintenant sept euros avec la TVA sur les entrées alors que si tous les acteurs principaux ainsi que la part peut-être de certains producteurs-profiteurs qui veulent gagner un maximum étaient moins payés, on pourrait réduire le prix des places à deux euros cinquante. Je pense que là, les gens retourneraient au cinéma. Parce que sept euros ! Si vous tenez compte qu’un père de famille, accompagné de sa femme et de ses enfants, ne peut plus aller au cinéma pour moins de cinquante euros… c’est énorme ! Enorme !
Le budget du film peut aller de 250 à 100 000 euros mais ça n’a jamais dépassé 100 000. Mais c’est déjà descendu en dessous de 250…
J’ai surtout besoin d’argent pour pouvoir faire des films, pas pour moi. Il faut tout d’abord savoir que je suis bénévole dans mes films et que l’argent qui me vient maintenant provient de la Communauté Française, de mécènes, de gens qui aiment mon cinéma. Avant nous avions une ASBL, on faisait des projections de films en faisant payer un droit d’entrée. Mais malheureusement il n’y avait jamais assez d’entrées pour payer la location de films. Donc il fallait à chaque fois renflouer la caisse en organisant des tombolas, en mettant à prix un cochonnet. Il nous est même arrivé de mettre à prix des poules, dix kilos de pommes de terre et même du charbon. Il faut dire aussi que les gens qui venaient voir nos films étaient du genre plutôt quart-monde parce que les gens civilisés et les gens qui ont du fric, ils vont le dépenser dans les cinémas américains.
La cagoule, pour moi, c’est un masque. C’est avant tout une façon de cacher son visage, de dissimuler sa véritable identité. Et c’est surtout, bien sûr, que par le fait d’être masqué, on ne peut pas prendre votre image et s’en servir à des fins cabalistiques, pour détruire votre corps progressivement en jetant votre photo dans un nid de fourmis pour vous faire attraper des boutons.
En 64, c’est l’achat de cette caméra 8 mm qui me tient à cœur, une Kodak Bowie à ressort. Elle tournait en 16 images/seconde, mais quand on arrivait en fin de ressort, elle ne tournait plus qu’à du 14 ou 12 images/seconde jusqu’à s’arrêter complètement. Il est impossible de synchroniser un film avec une telle caméra, il faut une caméra électrique.
Je dois attendre 1966 pour acheter ma première caméra Bauer.
Le curé de la paroisse, Klaus, sait que je fais du cinéma. Il me dit qu’à la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), il y a une salle de projection avec un 16 et un 8 mm, une caméra 16, du matériel, une table de montage en 8 mm. Pour moi c’est inespéré ! Je lui montre mes films chez lui, au presbytère. Il se bidonne, il rigole. Oui, il y a plein d’erreurs… Mais le curé avait quand même fait des études de cinéma et me donne quelques conseils. Après quelque temps il me dit : « ce qu’il te faudrait, c’est une caméra électrique ». Je lui réponds que je n’en ai pas les moyens. Il décide alors de se porter garant auprès du vendeur. Pendant des mois et des mois je paie. Si j’arrête de payer, c’est le curé qui paie à ma place alors que la caméra est à mon nom.
Après avoir payé la caméra, voyant que j’étais sérieux, il continue à me cautionner pour acheter du matériel. J’achetais tout à crédit. Je travaillais les samedis, les dimanches au noir et j’allais porter l’argent chez Mayeux le revendeur.
Le curé me soutient jusqu’en 1968, année où je perds son amitié parce que j’ai décidé de ne pas me marier à l’Eglise. J’ai alors sombré dans les abysses, je n’avais plus de local. J’ai continué à tourner des films — L’Abstrait, Le Cauchemar — mais sans l’aide de l’abbé Klaus… Ont suivi les années noires : 70 et 71 où je n’avais plus envie de rien. Je me sentais abandonné.
Cannes était une certaine reconnaissance de mon œuvre et de l’œuvre des autres cinéastes. Enfin je parle peut-être égoïstement car moi, je continue. Les deux autres ont arrêté. On les comprend : l’un a 84 ans et l’autre 77. Ces gens-là n’ont plus qu’une chose dans la tête, c’est de vivre encore quelques années ou quelques mois mais tout doucement ils s’en vont vers la fin. Ils n’ont plus aucune alternative, ni la patience, ni la santé. Max Naveaux, par exemple, a des problèmes d’angine de poitrine, il marche en titubant. Jacques Hardy, je suppose, est encore en bonne santé mais je pense qu’il a peut-être peur de trop investir son propre argent maintenant qu’il est retraité. Donc, forcément, ce sont des gens qui ont peur d’investir. Il faut du budget, il faut de l’argent. Et comme ils ont peur de dépenser leur argent, ils ne tourneront plus. Moi, je n’ai jamais eu peur de dépenser mon argent. Premièrement je n’en avais pas et deuxièmement, je faisais des films avec pas grand-chose. Plus bas que moi, tu meurs !
Cannes 2004 était pour moi l’aboutissement d’un… non, pas d’un rêve car je n’ai jamais rêvé d’aller à Cannes. Moi, mon festival, c’est à Singapour, à Sébastopol ou à Istanbul. Le festival du film turc, je crois que c’était là que je devais aller car les Turcs sont des gens qui ne comprennent pas grand-chose au cinéma, tout comme le cinéma pakistanais ou indien. Je pense que j’aurais beaucoup plus de chance du côté de l’Inde ou de la Chine que d’essayer de me faire valoir du côté des Anglo-américains.
Le cinéma de l’Absurde, c’est un cinéma incompréhensible, surréaliste, un cinéma totalement hors norme. Nous vivons dans une époque de normalisation absolue. Il est bien évident qu’une fois que vous êtes dans l’absurde, on vous prend pour un dingue. Il y a des écrivains tels que Camus, Sartre qui étaient aussi dans l’absurde. On ne les comprenait pas. Et pourtant le monde n’est-il pas absurde quand on voit les grandes expériences nucléaires auxquelles se livrent les Chinois, quand on voit les centrales nucléaires qui sont en train de se dégrader partout en Europe et même en Asie, quand on voit l’armée américaine se lancer dans des guerres d’usure qui peuvent peut-être provoquer la troisième guerre mondiale, quand on voit la réaction de certains pays devant certains phénomènes ? Où allons-nous ? Ne sommes-nous pas l’absurde total ?
Le cinéma amateur, je crois que c’est la véritable enfance de l’art et que c’est une étude personnelle. À chaque film il faut se remettre en question. À chaque film on fait des erreurs dans le cinéma amateur. Chaque film est une erreur. Je ne veux pas dire pour cela que c’est une erreur de faire un film mais il y a des erreurs dans chaque film qu’il faut essayer de neutraliser. C’est comme si vous étiez un scientifique et que dans votre potion, vous trouviez sans arrêt des microbes, des virus. Vous devez donc éliminer les microbes pour avoir de l’eau pure. Encore une fois, je pense que l’eau pure n’existe pas.
Le cinéma américain s’en va à sa perte pour la bonne et simple raison qu’ils n’ont plus rien d’original à montrer si ce n’est des films truqués d’effets spéciaux et des images truquées. Le cinéma américain est complètement truqué et complètement commercialisé. À part quelques cinéastes qui restent pour moi de très bons cinéastes, parce qu’en fin de compte, je pense que Spielberg — mis à part le fait que je lui lance toujours des défis — reste pour moi un très bon cinéaste. Je crois qu’il avait lui aussi beaucoup d’admiration pour Stanley Kubrick. Je crois même qu’il l’a rencontré à la fin de sa vie.
Le cinéma professionnel est complètement pourri à la base. A partir du moment où vous faites du cinéma une profession, vous ne pouvez plus vous appeler un artiste. Vous êtres devenu un industriel de l’image. Il faut fabriquer des images à tout prix car vous êtes payé pour cela et c’est votre travail. Jamais je ne voudrais devenir professionnel, je suis moi-même un anti-professionnel. C’est malheureux mais ce que je veux, c’est faire des films de qualité professionnelle sans pour cela que je sois, moi, un professionnel. Et ce sera à cette condition que mon cinéma restera totalement original sinon je n’aurai plus d’originalité et je devrai me compromettre avec des producteurs et des financiers. Je ne serai plus qu’une larve, qu’une loque, une espèce de ver de terre, de ver de vase qui rampe pour avoir son salaire.
Cornes, vaches, électrocution avec ma grand-mère, 1950. En 1950, un enfant innocent se fait électrocuter suite à la somnolence de sa grand-mère qui avait la garde de l’enfant et qui l’a laissé marcher vers les vaches. Une clôture électrique sépare les vaches du petit Jean-Jacques. Jean-Jacques mettra les mains sur la clôture et sera presque électrocuté. Un choc très profond fera de lui un cinéaste fou.
Les critiques sont à éliminer totalement. Les critiques, ce sont des insectes. Et vu que moi, je suis un insectivore, je pense que les critiques, je vais me les faire. On élimine les critiques avec du Zyklon B. Ils arrivent quelquefois à me blesser. La dernière blessure que j’ai reçue, c’est celle venue d’un journaliste (d’un quotidien régional belge) dont je tairai le nom et qui m’a dit : « Jean-Jacques, on t’a vu trois fois dans le journal sur un an, ça suffit. Tu fais trop de films, tu bouges trop, calme-toi ! ». Voici ce que ce journal me conseille de faire : rester endormi sur mes films. Quand j’ai dit que j ‘allais arrêter, je crois qu’ils ont tous dit : « enfin la bête est morte ! ».
En 64, durant mon service militaire, je réalise mon premier film, ayant eu l’occasion de racheter de la pellicule ORWO qui venait des pays de l’Est grâce à des systèmes de contrebande. Influencé par Igor Yaboutich, j’intitule ce film L’Etrange Histoire du Professeur Igor Yaboutich. Lors d’une permission, je rentre chez moi et je vais voir un camarade, un agent de police de Fontaine-L’Evêque qui me disait toujours : « Moi, je vais empoisonner la vie des gens de Fontaine, je vais leur pourrir la vie ». Pour moi, ce type-là, c’était un empoisonneur. Bernard le policier joue donc le professeur Yaboutich, l’empoisonneur public qui pollue le château d’eau avec du cyanure de potassium. Les gens qui préparent à manger ne savent pas qu’ils prennent du cyanure de potassium et ils meurent ! Ils font leur café avec du cyanure, ils lavent leurs pommes de terre avec du cyanure et voilà ! C’est l’histoire d’Igor Yaboutich. Le film dure 240 minutes. Je le présente pour la première fois au café du coin, chez Marcelle Wasterlain. Le film est sifflé, hué ! Bernard, l’acteur, n’avait pas été invité et il a entendu dire que le film était passé. Alors il m’interdit de le passer encore. C’est pour ça d’ailleurs qu’après j’ai commencé à faire signer des contrats aux gens.
Le film n’était pas vraiment ce qu’on appelle une grande réussite mais c’était le premier ! C’était la première fois que je me révélais en public. Malheureusement le film a été volé. J’ai toujours eu des doutes sur la personne qui me l’a volé. Je pense que c’est un complice du policier qui a volé le film pour qu’il ne soit pas diffusé dans les autres cafés de Fontaine-L’Evêque et où l’on reconnaîtrait Bernard Carlier. Je crois qu’il avait peur que ça puisse entacher sa carrière d’agent de police.
Les Devils symbolisent le mal, si on peut imaginer que le diable existe. Personnellement, je ne l’ai jamais rencontré mais je sais qu’il y a des gens qui ont le mal en eux. C’est pour ça que j’ai mis des devils dans ma première version de L’Histoire du Cinéma 16.
Bertrickx (Jean-Claude Botte) est le frère du chef des devils, Cowboy, qui a été exterminé par Belface sous les ordres de Jean-Jacques Rousseau. Bertrickx a ça en travers de la gorge depuis qu’il sait que son frère a été tué par Belface par la faute de Rousseau. Il refusera toujours de jouer dans le film. Bertrickx représente l’insoumission. Cela veut dire que dans tout groupement, dans toute société, il y en a au moins un qui n’est pas d’accord avec les autres. C’est pour ça d’ailleurs qu’on a fait un film sur lui car il refuse de jouer dans mon film. C’est l’histoire d’un type qui refuse de jouer mais qui joue quand même par le fait d’être filmé de force. Il porte un casque à cornes ; et du fait que mon grand-père, devenu fou dans sa boucherie, s’est pendu avec un crochet, Bertrickx savait très bien qu’en me provoquant avec un casque à cornes, je risquais de perdre les pédales.
Par contre, l’ennemi juré de Bertrickx, Belface, symbolise le bon, la justice, le redresseur de torts. Une espèce de Gary Cooper si vous voulez, ou un Tyrone Power si on revient au cinéma américain. Il s’appelle Belface parce qu’à l’époque il avait un beau visage. Et quelqu’un qui a un beau visage, on dit qu’il a une belle face. C’est de cela qu’est venu le nom. Si j’avais vu qu’il avait de belles jambes, je l’aurais appelé Beljambe ou Beaubras ou Dents-Jaunes s’il avait les dents mal lavées ou jaunies. Et ici, il était bien, il était parfait, Renato Cubba. Il avait deux bras, deux jambes musclées, il avait de beaux orteils, il avait un visage à la Stalone, il avait des cheveux à la Bruce Lee, il avait des techniques à la Jackie Chan, il connaissait le Kung Fu et le Karaté. J’ai même inventé une boxe, la boxe latine, pour insérer dans mes films une technique de combat qui n’existe nulle part dans la fédération des arts martiaux en Belgique ou dans le monde : la boxe latine. Il y a bien la boxe américaine, il y a bien la boxe thaï, il y a le Ji-Ju-Tsu, il y a le karaté, le Jeet-Kune-Do, il y a je ne sais combien de techniques de combat. Mais la boxe latine, il n’y en a qu’une, c’est Renato, l’Italien.
Malheureuse. Ballotté entre Souvret et Forchies. J’ai été élevé par ma grand-mère. Quand elle est morte, en 55, je suis resté sans manger, je me suis laissé aller à rien du tout. Je me nourrissais avec des ballons de Tournai et avec des bonbons. Quand j’allais au cinéma avec ma mère — parce que ma mère ne me faisait pas à manger — je mangeais un paquet de frites ou alors du pain rassis qui était à la cave. On ne me nourrissait pas. On trouvait que mon état se dégradait de jour en jour, j’étais presque mort. Normalement j’aurais dû mourir dans les années 50. Ma mère ne me voyait pas comme j’étais : je ne savais plus marcher, je ne savais plus bouger, je ne savais plus respirer, j’avais des rhumatismes articulaires, j’étais considéré comme enfant débile physique. Je ne savais plus rien faire.
J’ai été ballotté chez des médecins qui me faisaient manger du foie de veau ou prendre du sirop. J’ai été traîné chez des médecins de village qui te donnent n’importe quoi : un peu de fortifiant, du jus de limace… À l’âge de 12 ans, je ne pesais que 30 kilos. J’ai dû aller dans un institut pendant plus d’un an pour me remettre d’allure. J’ai résisté par la volonté de survivre. Comme maintenant. La mort ne me fait pas peur parce que je pense être déjà mort depuis longtemps. C’est pour ça que la mort ne m’atteint plus : je suis déjà mort.
Le film qui m’a le plus impressionné, c’est La Créature du Lac Noir avec Richard Carlson, film que j’ai vu avec ma mère en 1953 et qui m’a terrifié. On voyait une espèce de créature aquatique au visage de poisson humain qui marchait sur ses jambes et qui terrassait et tuait toute personne qui venait le troubler dans son sommeil léthargique dans le lac. C’est ça qui m’a le plus impressionné. Je l’appelais "l’homme-caoutchouc", il avait des écailles sur lui, il avait des yeux humains mais n’avait rien d’humain. Était-il hermaphrodite, omnivore ? Une chose est certaine, c’est que les humains qu’il tuait étaient les profanateurs du lieu où il se reposait. Il était dans la nature. Il était mal fait mais il n’y pouvait rien. C’était une tare de la nature, il souffrait déjà assez de vivre dans cet univers de marécages et encore fallait-il que les hommes viennent troubler son sommeil. Donc il se vengeait. C’est un peu la révolte animale sur les humains.
Ce film a eu une influence sur mes neurones, c’est évident, car il m’a terrifié. Et le fait de terrifier un enfant de huit ans, c’est faire en sorte qu’il aura peur toute sa vie des hommes-grenouilles.
Le film qui me ressemble le plus, c’est L’Histoire du Cinéma 16 (1982). C’est un film auto-critique, c’est une mise en abyme de mon cinéma où je me détruis moi-même, où je suis l’anti-star, où je suis l’anti-réalisateur. C’est pour cette raison aussi qu’on ne peut pas voir mon image. Certains réalisateurs sont atteints de narcissisme aigu, ils veulent voir leur figure, leur visage partout dans les magazines. Moi, je suis l’homme sans visage, je suis le Fantômas, je suis l’homme masqué, celui qui arrive quand tout le monde s’en va, celui qui commence quand tout est fini, celui qui arrive quand tout le monde est parti.
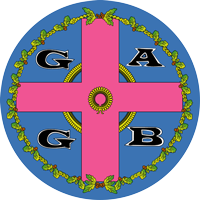
Le GAGB, c’est une secte, un groupe obscur qui aura la seule mission, la mission ultime de créer un monde nouveau. Mais je ne peux pas dévoiler ce que sera le GAGB, ce sont des mots, des lettres, des codes.
L’avenir est sombre, la fin du monde est proche. Je prévois d’énormes catastrophes dans le monde. Je vois des accidents terrifiants le long des grand-routes, je vois des camions qui dérapent et qui foncent sur des voitures en stationnement et qui s’enflamment. Je vois des corps brûlés qui jonchent les autoroutes. Je vois des manifestations à Bruxelles, à Paris, dans le monde. Je vois des explosions. Je vois des soldats qui meurent, des enfants qui meurent. Je vois la mort.
Notre civilisation est arrivée au stade du magma total, le big bang. Mais avant, ce sera la folie des gens suite à l’abus de gsm, de drogues, de stupéfiants, ce sera la folie de la médecine qui veut toujours aller plus loin, des explosions dans les centrales nucléaires, les guerres atomiques, le microclimat qui se dégrade… L’homme va s’anéantir lui-même : la pollution, la sur-pollution du globe, la fonte des glaces au Pôle Nord, le dessalement des océans, les raz-de-marée et le météore Kohoutek qui va être projeté dans l’océan atlantique ou l’océan indien et qui va faire des débordements. Il va y avoir d’énormes raz-de-marée, des villes entières vont être noyées et les corps des canards flottants vont provoquer la peste. On va retrouver la peste bubonique, la peste noire, la peste asiatique. Et bien sûr tout va venir du Sud. La mort certaine. Quant au Nord, la fonte de glaces va faire déborder les mers. Les Bataves, la Flandre vont être submergés par les eaux. Je prédis aussi la fin des abeilles et la recrudescence de certains insectes inconnus à l’heure actuelle qui vont nous déchirer la chair et nous piquer la peau, et nous créer des bubons purulents ! Et nous souffrirons ! Et nous mourrons tous ! On s’en va vers la méga-catastrophe.
En 2002, dans le film Wallonie 2084, j’ai parlé de la grippe du canard qui était mortelle pour l’homme. Et en 2006, la grippe du canard devient le virus H5N1 dont on ne connaissait pas le terme en 2002. Il y a maintenant quelqu’un qui a donné un chiffre et des lettres à la maladie. Mes films sont des prédictions apocalyptiques, un peu comme l’Apocalypse de Saint Jean. Malheureusement, je n’ai pas l’arche de Noé. Je ne serai pas sauvé car je n’ai qu’une périssoire, je périrai avec les gens.
Cinéaste incompris. Les gens prennent pour un fou, un cinéaste qu’ils ne comprennent pas. La solution est dans le mot : cinéaste incompris alors cinéaste fou. Mais parce qu’incompris !
La musique de Rammstein m’a aidé à écrire le scénario de Wallonie 2084. Hector Berlioz m’inspire pour écrire des textes sur les Allemands. Si je lis un livre d’Edgar Poe, ça m’inspire pour des histoires d’enterrés vivants ou d’assassins. Mais j’essaie autant que possible d’aller de moins en moins au cinéma, surtout quand je tourne, pour ne pas me laisser influencer. Car le cinéma de Jean-Jacques Rousseau ne ressemble à rien de connu. J’ai réinventé un nouveau style de cinéma, ça j’en suis persuadé. Le fait de ne pas aller dans des écoles de cinéma, ça m’a permis d’être autonome, de faire du cinéma sauvage, du cinéma barbare, de la façon que je le ressens, sans avoir de blocage. Je n’ai pas de blocage : je suis à fond de cale quand je tourne.
Quand j’étais à l’école, quand j’étais à l’armée, quand je côtoyais des gens, on se moquait de moi. En somme mon philosophe-homonyme ne m’a apporté que du ridicule, on se foutait de ma gueule. Je n’ai jamais essayé de lui ressembler. J’ai le même nom mais c’est un hasard.
Le personnage cagoulé est l’autre Jean-Jacques Rousseau car il a plusieurs personnalités : il est celui de la rue, il est Igor Yaboutich, il est l’homme masqué… Il m’est même arrivé d’assister à ma propre exclusion en faisant jouer plusieurs personnages à ma place.
Mais Jean-Jacques Rousseau n’a jamais existé réellement. Jean-Jacques n’est qu’un numéro, un pion dans l’engrenage. Je n’ai jamais existé. Les gens croient que j’existe. Oui, à l’intérieur de mon œuvre. Mais en tant que personne, je n’existe pas.
Sur ma tombe, je voudrais que l’on indique comme épitaphe : « S’il est mort c’est parce qu’il est né. Rien ne sert de pleurer ce mort car il était déjà mort à sa naissance ».
Je vais au cinéma avec ma mère jusqu’en 62. Puis j’abandonne ma mère parce que je suis devenu autonome. J’en ai eu un peu marre et dans les années 60, j’ai continué à aller au cinéma mais pour aller voir les films qui me plaisaient : des films d’aventure, des films de fiction, de sciences-fictions. J’ai été voir les James Bond, les Barbouzes… En 62 je vais travailler, j’attrape des amis, je deviens batteur, je joue dans un groupe. C’était le moment où il y avait des concours de batterie dont le lauréat gagnait un voyage gratuit à St Tropez et avait la possibilité d’enregistrer un 45 tours.
Je continue à aller voir des films mais je suis surtout attiré par les films de guerre tels que Le Pont de la Rivière Kwaï, La Croix de Fer de Sam Peckinpah, par certains films d’action. Les films historiques ne m’intéressent pas particulièrement sauf les films bibliques comme La Terre des Pharaons, Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille, Ben Hur qui sont des films à grande mise en scène. Je suis attiré aussi par les péplums, par les films où il y a beaucoup de personnages.
Kubrick, pour moi, est un des meilleurs réalisateurs qui malheureusement est mort. Autodidacte, il n’a jamais fait d’études de cinéma, il s’est formé par lui-même selon ses propres connaissances. Il reste néanmoins pour moi un des meilleurs réalisateurs que le vingtième siècle ait connu. Il a une influence terrifiante sur moi quand j’ai vu ses premiers films (Les Sentiers de la Gloire, Spartacus…) : sa façon de filmer, ses plans qui ont une certaine longueur, ses travellings montés sur rails, ses images répétitives, la fixité de la caméra dans certains cas et sa mobilité dans d’autres. Je dirais que Kubrick a su vraiment illustrer la psychanalyse de l’image… C’est un grand. Il est certainement au royaume des cinéastes.
C’est tout d’abord le lieu de mon travail. Si je suis encore là maintenant, c’est grâce à monsieur Leclef qui m’a préservé de beaucoup d’esprits malfaisants. C’est mon directeur — et j’espère qu’il le sera encore pour quelques années — et je le remercie pour son aide et son soutien dans mes films. Il a inventé un dicton : « Il faut que Jean-Jacques souffre car cette souffrance est la base élémentaire de la création de son œuvre ». Ça veut dire que c’est un directeur qui souhaite que je souffre pour que je puisse créer. Mais d’un autre côté, je bénéficie d’un soutien logistique du Centre Culturel qui est loin d’être négligeable : des locaux, du téléphone voire de la post-production ou de la co-production dans Rock Mendès. Si on n’avait pas La Posterie, on se demande où on en serait. Ce lieu de travail est indispensable pour moi. Pourvu que La Posterie vive !
Dans la vie, je ne soigne pas mon look. Quelquefois, je peux avoir l’air d’un vacher, l’air débraillé… Mais quand je me présente sur scène, je ne vais pas venir avec des linges troués, des pantalons cassés ou des chaussures pleines de bouses de vache. Non, quand je viens sur scène, j’ai des bottes d’équitation qui sont bien cirées. Je ne sens pas non plus mauvais quand j’arrive sur scène, je ne voudrais pas infliger ça au public. Mais mon look, en général, non. Sur scène oui, dans la réalité moins.
Le mage Armand est mon cousin et mon parrain. Je pourrais dire aussi que c’est mon grand frère vu que je n’ai eu ni frère ni sœur. Il était garagiste et il a toujours eu du respect pour ce que je faisais. À certains moments, bien sûr, je l’ai perdu de vue mais je continuais à le côtoyer, j’allais à son garage, il me soudait des pièces pour mes décors, des barres de fer, des pointes, des échafaudages pour pouvoir tourner mes films. Armand ne m’a donc jamais abandonné. En 1983, il a fait faillite et est venu nous rejoindre, Albert et moi.
Au départ, le mage Armand n’était pas magnétiseur. C’est à partir de 74 qu’il a commencé à devenir garagiste-guérisseur : les gens venaient réparer leur voiture et en même temps pour se refaire le nerf sciatique ou pour remettre des vertèbres déplacées. Armand arrangeait non seulement la voiture mais aussi l’automobiliste. C’était vraiment ce qu’on appelle un garagiste médecin, ce qui est très rare même dans les agences actuelles. Armand nous a suivi pendant de longues et de longues années, il conduisait Albert avec la caravane, il se déplaçait de ville en ville, de hameau en hameau ; il faisait la Belgique, une partie de la France, de l’Allemagne et de la Hollande. Avant chaque séance, le magnétiseur Armand mettait ses mains devant le public et voyait si le public était bon, il sentait le magnétisme. C’était le risque à courir par tous les organisateurs de spectacles : quand Armand ne sentait pas le public on annulait la séance.
Le magnétiseur Armand avait aussi été phytothérapeute, il faisait du thé qu’on appelait le Thé Boulard, composé d’écorce de bouleau, de paprika… Enfin il avait des pouvoirs extrasensoriels pour canaliser les bonnes ondes dans le cinéma de Jean-Jacques Rousseau. Dieu ait son âme, il a été tué d’une façon tragique dans un accident de voiture entre 2002 et 2003 en revenant de sa caravane. Une voiture l’a percuté de plein fouet et le pauvre a été découpé en morceaux dans son véhicule. Seul son chien a survécu.
Mon meilleur film, ça, je ne peux pas le dire. Tous mes films ont été faits avec la même intensité dramatique. C’est comme si vous demandiez à une femme qui a eu dix enfants quel est son enfant préféré. Elle vous dira : « Je ne sais pas ».
Le message dans mes films, je pense que c’est assez compliqué. Tout d’abord, c’est d’arriver à montrer au public que l’on peut, avec peu d’argent faire quand même quelque chose de grandiose et qu’on peut quand même arriver à distraire les gens pendant une heure et demie. Et que le public ne sorte pas déçu, qu’il dise « oui, c’est vrai, ça ne vaut peut-être pas le dernier film de Spielberg mais c’est quand même un cinéma original, fait avec de faibles moyens ; et cela vaut quand même une certaine reconnaissance ».
La mort est le résultat de la vie. Quand on naît, quand on voit le fœtus, l’embryon, le spermatozoïde, il est déjà condamné à mourir. Quand un spermatozoïde a été sélectionné parmi des centaines de milliers, celui-là mourra. Il mourra pourquoi ? Parce qu’il sera tout d’abord embryonnaire, il va y avoir une espèce de petit hippocampe qui va se développer dans le corps de la mère. Mais déjà là, le cœur commence à battre ; et déjà il va falloir lutter contre la mort. Et toute la vie est une lutte contre la mort : globules rouges contre globules blancs. Et la mort, ça veut dire que nous serons vaincus. Et comme nous sommes tous mortels… Seule une personne a été ressuscitée, il s’appelle Lazare… Mais je me demande où est passé Lazare. Quant au Christ, bien sûr, sa résurrection reste encore bien controversée. Alors sur les milliards de personnes qui ont habité notre putain de planète, il y en a seulement deux qui ont ressuscité : le premier on se demande où il est et l’autre, Jésus ressuscité d’entre les morts, lui aussi, où est-il ?
La musique, au début, était faite à partir de disques, de vinyles que nous avions copiés par ignorance ou par inadvertance. On ne savait pas très bien qu’on ne pouvait pas copier ces disques. Mais on le faisait, car c’était la seule solution, en tant que cinéastes amateurs, de pouvoir illustrer musicalement nos films. Maintenant, j’ai la chance d’avoir ma fille, Frédérique Rousseau, qui fait la musique de mes films depuis 2001. Ma fille a des pouvoirs musicaux, elle a plein de pouvoirs, de capacités, c’est une fille très sensible, elle est formidable, elle peut créer des choses que les autres ne créeraient pas.
Ma naissance était programmée pour 1939. C’est pour ça d’ailleurs que mes parents étaient plus âgés quand je suis né. En 39, mon père n’avait que 35 ans et en 46, il en avait 42. Si Adolf Hitler n’avait pas attaqué la Pologne et que la France n’avait pas déclaré la guerre à l’Allemagne, je serais né en 1939. D’une certaine façon, Hitler étant ce qu’il est, ma naissance a été reportée de 7 ans ; j’ai donc bénéficié de 7 ans de vie en plus grâce à Adolf Hitler. Je suis donc un résidu de guerre.
Les extrémismes, c’est l’extrême droite qui est nauséabonde et l’extrême gauche qui pour moi n’est pas très bonne non plus. Disons que les extrêmes se rejoignent à l’infini. Est-ce que c’est un phénomène optique ou une réalité ? Une chose est certaine, c’est qu’elles ont des points communs. Quelquefois les systèmes totalitaires s’unissent pour détruire le monde.
La présence du nazisme dans mes films, c’est pour conjurer le mal. Je dirais que, dans mes films, je n’ai pas besoin de Frankenstein, de Dracula ou du Docteur Jekyll et Mister Hyde pour faire peur. Pour faire peur, j’ai les nazis. Les gens ont peur des nazis. Vous prenez quelqu’un avec un uniforme noir, une croix gammée et des insignes SS, les gens vont avoir peur, même s’il ne l’est pas. L’habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Et même quelquefois, certains acteurs, quand ils vont revêtir ce costume, se sentiront plus forts et deviendront encore meilleurs pour jouer leur rôle.
Opel, c’est la meilleure mécanique que j’ai trouvée dans ma vie. Tout d’abord, elle est de race allemande, c’est déjà quelque chose. Ensuite, il y a une rune, une rune germanique qui se trouve sur la carrosserie de l’Opel et qui symbolise la foudre de Thor. Et grâce au fait de porter un insigne de Thor, jamais Thor ne foudroiera celui qui croit en lui. Ceux qui ne croient pas en Thor auront bien tort de ne pas y croire parce qu’ils mourront.
Depuis le passage au numérique, la pellicule me manque. Elle me manque parce que je pense que le cinéma n’est pas fait pour être "vidéofié" ou "vidéosacrifié". Le cinéma est avant tout un support à l’acétate de cellulose où sont fixées plusieurs couches et inter-couches de bromure d’argent qui est photosensible et qu’on peut réduire en argent métallique en passant par des produits chimiques. Ces images qui passent dans une lanterne de projection sont, pour moi, la magie du cinéma.
Le numérique a provoqué la fin de la pellicule. C’est dommage mais d’un autre côté, c’est quelque chose que j’apprécie car au lieu d’investir 50 000 francs pour un film de 20 minutes je ne dépense plus que 250 euros. C’est beaucoup plus économique et au niveau de l’image les collures ne se voient plus, c’est beaucoup moins de contraintes. De plus les caméras deviennent très performantes et peuvent filmer dans des situations de luminosité très basses. Ça donne donc des possibilités inespérées pour un cinéaste qui n’a pas beaucoup de moyens. Mais si j’avais un peu plus de moyens, je reviendrais à la pellicule, en 16 voire en 35 mm.
Avant, on ne pouvait pas représenter la gendarmerie dans les films. J’ai commencé à mettre des gendarmes dans mes films quand la gendarmerie a disparu en Belgique. Il ne faut jamais oublier que, quand j’ai fait La Revanche du Sacristain Cannibale, la gendarmerie n’existe plus ! Maintenant il y a prescription. Mais la police existe toujours… Je ne mettrai jamais la police fédérale dans mes films. Ça restera une police ancienne, une police des années 50-60… de cette manière je ne remets pas en question l’autorité en place qui pourrait me valoir de graves ennuis. Si je n’étais pas le cinéaste de l’absurde, franchement, depuis que je fais des films subversifs, j’aurais déjà été condamné au moins cent fois. J’ai toujours réussi, par la poésie de l’absurde, par le détournement des situations, à me masquer, malgré tout ce qu’on peut dire de moi.
La qualité technique est importante parce que, même si vous êtes dans l’absurde, même si vous êtes dans l’incompréhension totale et que le public n’y comprend que dalle à vos films, il faut qu’il ait de bonnes images et un son parfait et que son cerveau ne soit pas incommodé par des images intempestives, des bougés, des filés de caméra, des sur-ex, des sous-ex. Ce n’est pas parce que Camus ou Sartre étaient dans l’absurde qu’ils devaient écrire à l’envers ou en verlan. On les aurait certainement encore moins compris.
Je pense que mon cinéma, tout doucement, va vers un cinéma plus tragi-comique que tragique. Et pourtant je ne suis pas un type réjouissant, croyez-moi. Quand on vit avec moi, on vit dans le royaume de la Terreur. Et pourtant on finira par en rire… Si le public rit, c’est qu’il a envie de rire. S’il doit sortir parce qu’il doit aller pisser, c’est qu’il a besoin de pisser, c’est que sa vessie est pleine. S’il doit aller à la toilette, et bien qu’il y aille, c’est l’heure, il vaut mieux qu’il ne se retienne pas, qu’il aille tout de suite aux toilettes. S’il n’y va pas, il va pisser dans son pantalon. Il faut bien que ça sorte d’un côté ou de l’autre.
Les gens ont tellement peur dans mes films qu’ils se mettent à rire. Je pense que rire, c’est comme la toux. Si les gens ne toussaient pas quand ils ont un rhume ou une bronchite, ils mourraient.
Le rire a changé, le public a changé, j’ai changé. Je ne reçois plus le public de la même façon. Il faut dire qu’au début, tous mes films étaient des films d’horreur, des films de gore, des films où il y avait beaucoup de sang, de meurtres. Mais quand j’ai entendu le public rire, je me suis dit : « ce n’est pas possible que les gens rient d’autant d’horreur ! ». Mais la façon dont on tuait dans mes films, c’était ça qui était plutôt comique. Enfin je me dis que la mort est déjà assez cruelle comme ça, si on peut tuer quelqu’un et que la victime peut commencer à rire avant de mourir, c’est déjà un peu mieux. La mort est d’autant plus douce.
Ma mère avait des mamelles très développées. La première chose dont je me souviens c’est quand je lui prenais le sein, d’où cette envie de voir des femmes avec des seins très développés. Je n’aime pas les femmes qui n’ont pas de seins, surtout celles qui ont les seins plats ou des seins siliconés.
Si j’avais eu un fils, j’aurais voulu qu’il soit comme Frédéric car il a été pour moi un élément important dans ma vie, surtout en 1997 quand je l’ai rencontré. C’est un type qui a toujours été respectueux vis-à-vis de moi. Il a fait passer mes films, nous avons été au festival de Cannes, nous avons fait le tour de France avec Cinéastes à tout prix, il nous a accueilli aux Editions Klincksieck… Frédéric est pour moi un personnage unique et inoubliable. Je le respecterai toujours pour ce qu’il a fait. Il m’a aidé et m’aidera encore quand il le pourra.
Au début, par exemple dans Les Malfaiteurs, je faisais le doublage des personnages en live. Je parlais à leur place en dessous de l’écran, j’avais ma batterie avec laquelle je faisais des bruits, j’avais une flûte, une trompette quand c’était le type qui arrivait, je faisais des grognements… Je faisais les bruitages. Les gens riaient dans le café. Ca a été vraiment le ridicule complet dans ce café de buveurs, de fumeurs, d’alcooliques…
En 1974, je rencontre Victor Sergeant et on fait notre premier film en 16 mm, le premier film sonore de ma vie, avec une bande magnétique. C’est Les Compagnons de Justice. Ce n’est pas du son synchrone mais de la postsynchronisation.
Si j’avais les moyens de Spielberg, j’aurais fait mieux. S’il avait eu mes moyens, jamais il n’aurait fait du cinéma. Il se serait reconverti comme chasseur de papillons à Hollywood. Pensez-vous qu’avez 2 500 euros, Spielberg serait capable de faire un film de 50 minutes ? Il n’aurait même pas assez pour remplir le réservoir de sa Jeep ! Avec 2 500 euros, Spielberg n’a même pas les moyens de se payer le téléphone pour le mois.
C’est le courageux, celui que je n’oublierai jamais. C’est celui qui a fait deux fois le tour du monde en vélo. Deux fois 45 000 km en près de vingt ans. Albert sillonnait toutes les rues de Wallonie et de Flandre pour apporter la bonne nouvelle du cinéma 16. On faisait des projections dans les campings, dans les lieux publics, dans les maisons de jeunes, dans les centres culturels.
Un jour malheureusement Albert est tombé, il a vieilli et ne pouvait plus continuer. C’était un ancien mineur ; il avait une silicose très forte. Son état s’est détérioré sur l’espace de deux ou trois ans. Il n’était donc plus possible pour lui de continuer à faire du vélo.
Albert restera pour moi un personnage pur et dur du cinéma de Jean-Jacques Rousseau. Il a cru en moi dès notre rencontre, quand nous travaillions dans la construction. Cette rencontre remonte à 1966 et s’est terminée en 2003, la date de son décès. Si j’existe encore à l’heure actuelle, c’est grâce à lui. Je crois que je me serais fondu dans la nature, j’aurais été brûlé vivant s’il n’avait pas été là, car Albert m’a sauvé quand j’ai été transformé en torche vivante, il a jeté de l’eau sur moi, il m’a jeté dans la citerne. Si je suis encore vivant, c’est grâce à Albert. Je ne l’oublierai jamais. Tous ceux qui l’ont connu ne doivent jamais oublier l’effort qu’il a fait pendant des années, au péril de sa vie, d’être renversé par des camions, par des voitures, avec des gens qui l’insultaient, qui le maltraitaient, qui disaient « espèce de fou, tu n’as pas honte de faire des trucs pareils pour le cinéma ? Le cinéma, ce n’est pas ça ! ». Et Albert répondait « ! Le cinéma de Jean-Jacques, c’est ça, c’est le cinéma forain, c’est le cinéma de Méliès ! ». Albert, c’est le plus GRAND de mon cinéma.
Thor, pour moi, c’est la foudre, le dieu germanique, le dieu scandinave, celui qui foudroie tout et tous ceux qui ne croient pas en lui. Moi, je crois en Thor. Je crois au paganisme, je crois aux dieux de la Gaule, aux dieux païens, aux dieux celtiques. Je crois aussi aux divinités grecques. J’ai beaucoup de difficultés à croire en un dieu unique, monothéiste. Je suis plutôt polythéiste, je crois en plusieurs dieux, je crois aux forces élémentaires de la nature, à la force du vent, à la force du tonnerre, à la force de l’eau, à la force des étoiles, à la force du cosmos et à ceux qui vivent là-haut, sur une planète qu’on appelle Ganymède, un des satellites de Jupiter.
Sur les tournages, je ne suis plus le même homme. Je suis possédé par des forces obscures, des ions dépresseurs, des sortes de microprocesseurs : c’est Igor Yaboutich qui parle. Sur le plateau, tout tourne autour de moi : les formes, les gens qui n’ont plus le même visage… je ne reconnais plus personne. Il m’est arrivé de mettre ma chaussure gauche au pied droit ou l’inverse. J’ai trop d’histoires qui se passent autour de moi. Je dois extérioriser le mal qui est en moi. Mais un démon qui s’en va donne naissance à un autre démon. Ce sont les démons de l’angoisse, de la paranoïa, de la haine, de la perversion… qui me hantent à certains moments. Grâce au cinéma, j’arrive à les extérioriser. Après un tournage, je suis lessivé, vidé.
Les années soixante-dix n’ayant pas été favorables (Le Diabolique Dr Flak ne marche pas financièrement), Victor Sergeant décide d’arrêter l’aventure. Sans lui, en 82-83, j’entame le tournage de L’Histoire du Cinéma 16. En 84, j’essaie de lancer le film dans certains festivals mais il était trop long, c’est ce qu’on disait, alors que mes anciens films avaient participé à de nombreux festivals de courts-métrages. Nous avions plus de chance avec les courts qu’avec les longs mais je ne voulais plus faire de courts. Soit je fais des longs, soit j’arrête. Je me dis que je n’irai pas plus bas. Je ne fais donc plus rien.
Fin 80, j’ai alors envie de devenir exploitant de salle, de projeter les films des autres. En 88, avec l’aide d’Albert Staes et de Marc Leclef, je décide donc d’ouvrir le Cinéma Méliès. Je veux surtout revenir à l’enfance de l’art : opérateur de projection. Je suis content de voir des films comme quand j’allais au cinéma avec ma maman : je reviens au point de départ. J’ai eu l’impression que ma vie avait fait une boucle.
Malheureusement les complexes cinématographiques battent leur plein et je suis encore tué par les grosses productions anglo-américaines.
J’aurai tout essayé : j’ai essayé de faire des films, je me suis planté et j’ai essayé de faire l’exploitant, ça n’a pas marché. Jusqu’en 1996 où enfin on s’intéresse à moi et à mon cinéma.
Ça commence à me dégoûter. D’ailleurs j’essaie de moins en moins de manger de viande. Je suis allé à l’abattoir de Gilly, j’ai vu comment ça se passe. Moi, j’ai vu un petit poney qui a tourné toute sa vie dans un tourniquet et qui suivait son tour pour être tué. Je vois le regard de l’animal, inquiet. On aurait dit qu’il me disait mentalement : « sauve-moi, sauve-moi ». Et je l’ai vu se faire tuer en face de moi d’un coup de pistolet dans le crâne, se faire découper à la tronçonneuse, j’ai vu son corps ouvert, ses viscères qui tombaient par terre. Il bougeait encore, les nerfs étaient là.
Après avoir été à l’abattoir, je suis resté six mois sans manger de viande. D’ailleurs je ne mange plus de volaille car j’élève des poules et des canards. J’espère un jour devenir végétarien. Nous sommes des cannibales, des carnivores. Dans la viande, il y a la guerre. Tant que nous mangerons de la viande, on fera la guerre. Si un jour le monde devient végétarien, nous aurons moins le besoin de guerre. Je remarque qu’à la boucherie, ce sont toutes de vieilles personnes qui vont acheter de la viande. Pourquoi ? Parce qu’elles savent qu’elles faiblissent avec l’âge. Elles croient qu’en mangeant de la viande, elles vont faiblir moins vite. C’est l’inverse ! Nous avons un intestin long par rapport au chien ou au chat, à l’animal. Ça veut dire que les fermentations de viande restent dans les intestins pendant trois jours avant d’être évacuées dans les selles. Il se crée ce qu’on appelle des petites courbes, des polypes qui peuvent être cancéreux.
Quand on pense à tout ça, quand on voit le petit poney qui va du tourniquet à l’abattoir, quand on pense à la vache innocente qui meurt, quand on pense aux polypes qui se créent dans l’intestin, quand on pense au séjour de la viande dans notre organisme, il y a de quoi être dégoûté de manger de la viande. Bien sûr je mange encore du poisson. C’est aussi de la viande mais c’est différent.
Ed Wood, je ne connaissais pas. Quand j’ai commencé à faire du cinéma, j’ignorais totalement qui était Ed Wood. C’est en 1999 que quelqu’un m’a dit : « Jean-Jacques, tu ressembles à quelqu’un… » C’est comme si vous aviez cinquante ans, on dit que vous ne ressemblez à rien, que ce que vous faites d’habitude ne ressemble à rien. Et tout d’un coup, miracle ! Ce que je fais ressemble à quelqu’un, à une façon de voir les choses qu’un cinéaste aurait expérimenté avant moi. Il faut dire aussi que Ed Wood a disparu mystérieusement au Mexique. Je pense qu’il a été enlevé par les extraterrestres en 1975. Je ne pense pas que je lui ressemble car Jean-Jacques Rousseau est à lui seul son Ed Wood. Quand j’ai vu les premiers films d’Ed Wood, je me suis rendu compte que j’étais dans le même sillon que lui, dans le sillon du film original, du film avec très peu de moyens, avec cette façon de voir les choses et de mettre en scène. Je pense que Ed Wood aussi était autodidacte.
Igor Yaboutich est un personnage symbolique qui est entré dans ma vie en 1964 et qui me fait encore souffrir. I.Y., ce sont des initiales bizarres, ce sont des chiffres. Ce ne sont même pas des lettres, ce sont des chiffres. Je crois que dans une nuit cosmique de 1964, I.Y. est apparu dans les étoiles sous forme d’une étoile rouge. Il avait un visage de slave de type caucasien, il avait une barbe pointue comme Léon Trotsky, il avait des yeux cruels comme Joseph Staline. C’était un personnage diabolique. Igor Yaboutich est toujours là.